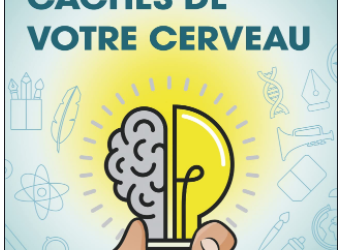La meilleure réussite des filles : un effet trompe l’oeil ?
Delphine Martinot est Professeure des Universités en psychologie sociale à l’université Clermont Auvergne depuis 2006. Elle est membre du Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive (LAPSCO), UMR CNRS 6024. Ses activités de recherche visent à comprendre comment les inégalités de statut entre les groupes, notamment entre les femmes et les hommes, régulent les processus cognitifs, affectifs, les comportements et les performances, en particulier dans le domaine scolaire.
Interview faite par : Barbara Ozkalp-Poincloux Retranscription faite par : Virginie Kehringer
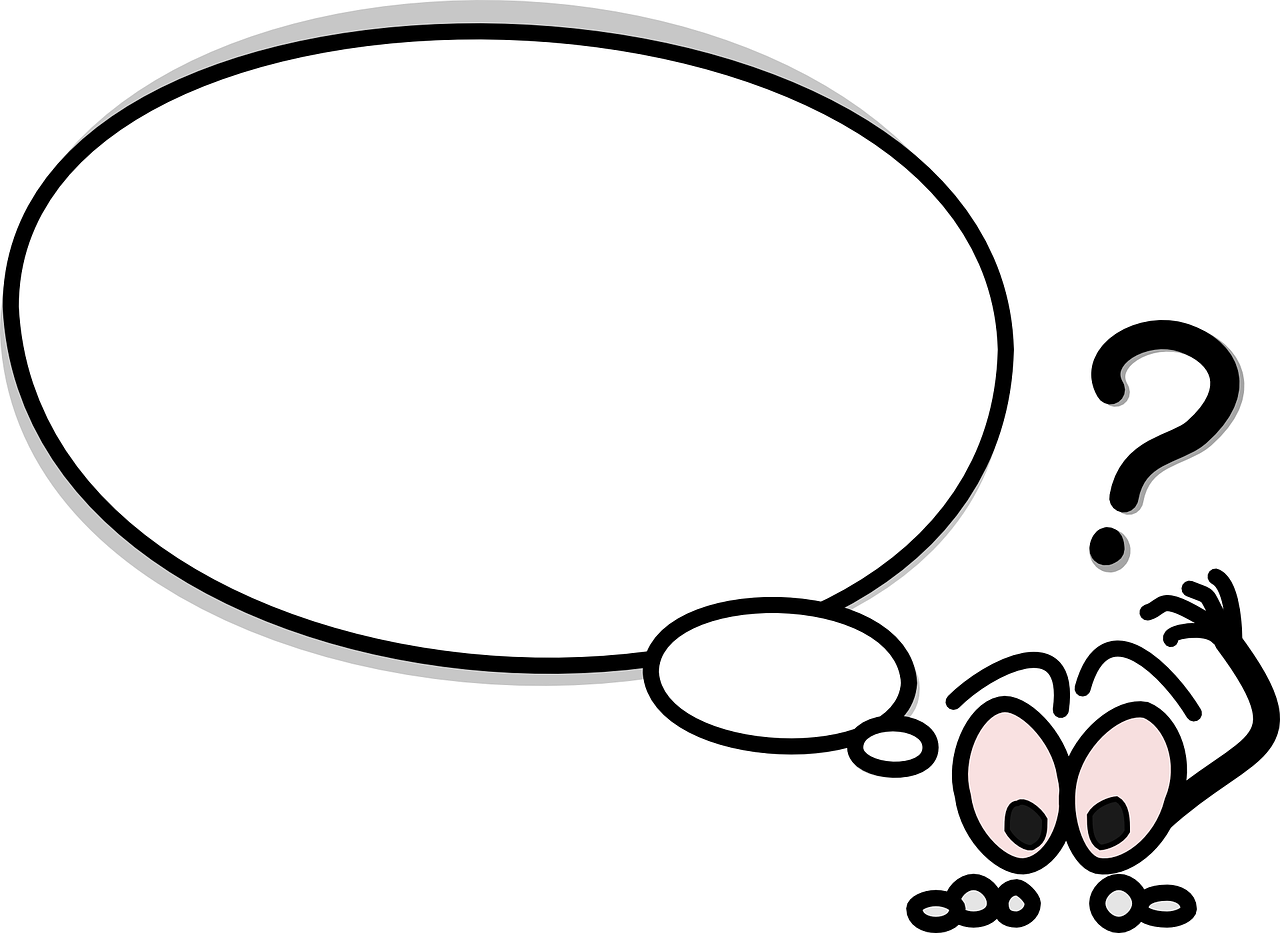
Delphine Martinot, bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement et nous présenter votre parcours et les principaux enjeux de vos recherches ?
D. MARTINOT :
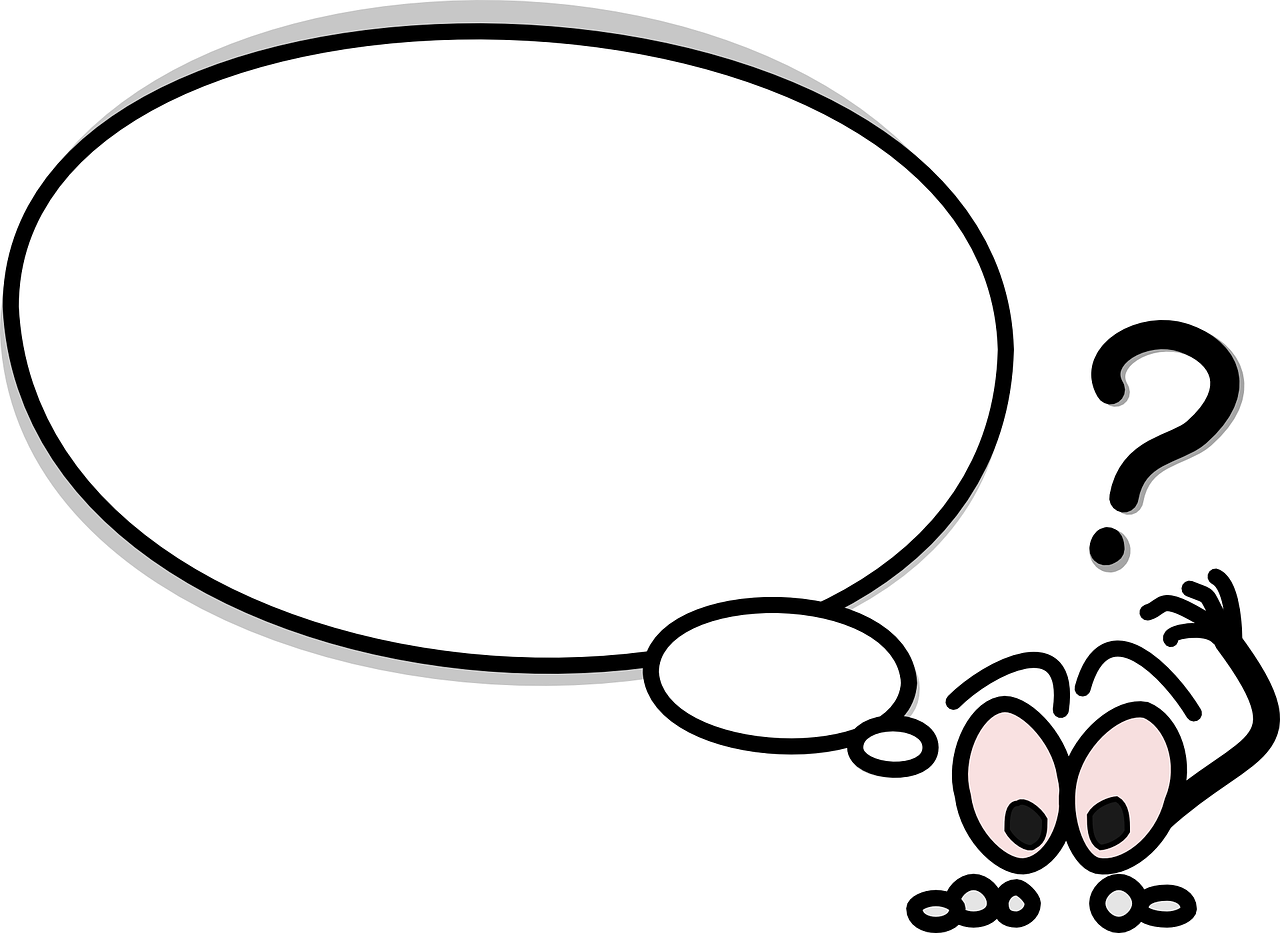
D. MARTINOT :
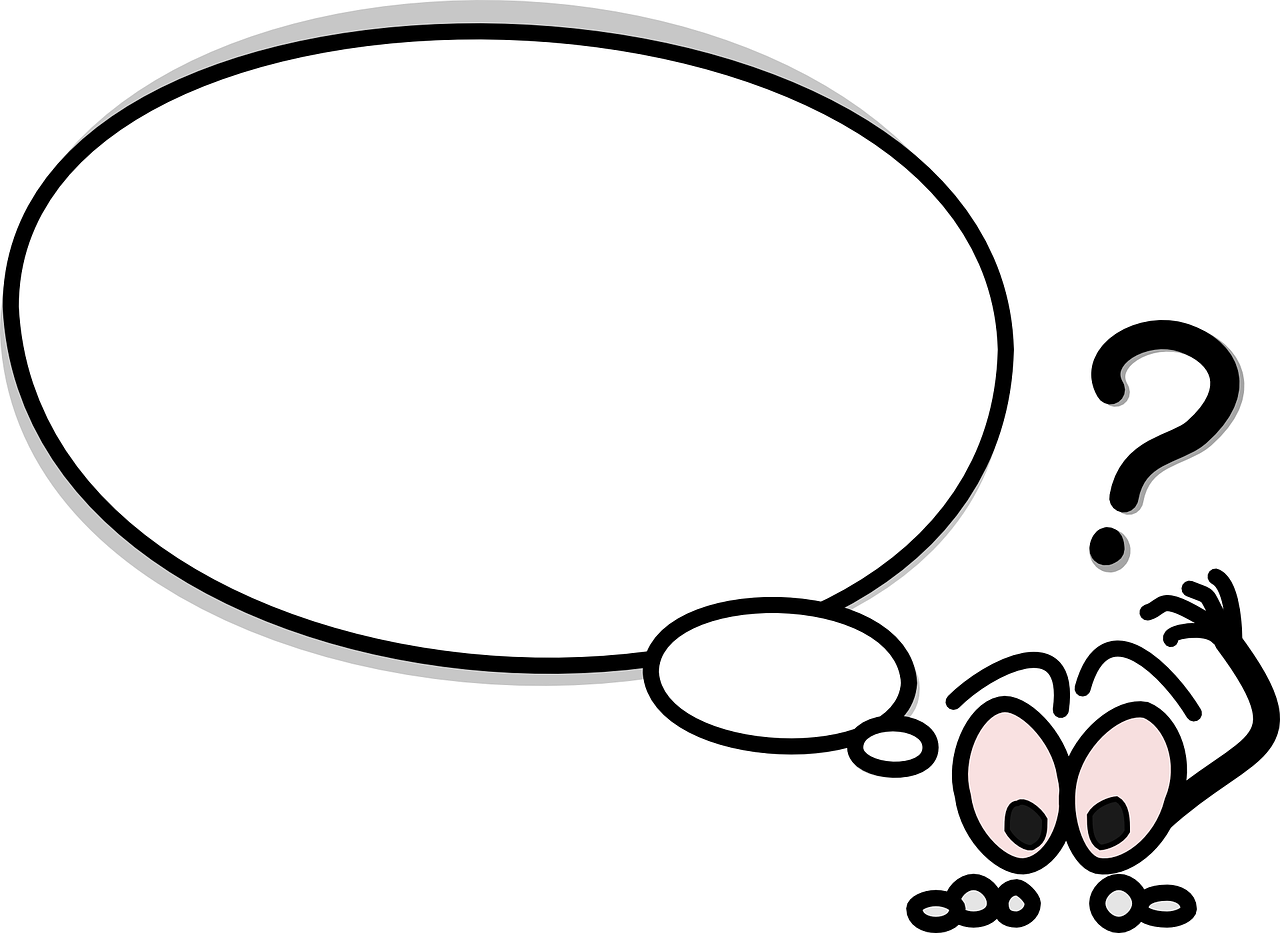
Le mois de mars 2024, « Mois de la Femme », a particulièrement mis sur le devant de la scène cette question des inégalités et la sensibilisation aux stéréotypes de genre. Est-ce que vous sentez que l’effet retombe dès lors que ce mois est passé ?
D. MARTINOT :
Pas tellement. C’est la première année où l’activité autour de la question du genre se maintient. La préoccupation semble rester mais il est difficile de dire si c’est quelque chose de ponctuel ou une véritable évolution. Je suis très sollicitée encore pour tout le mois de juin, notamment dans le milieu de l’enseignement du premier et du second degré, ce que je considère comme un très bonne nouvelle parce que j’ai l’impression que le milieu scolaire s’en empare davantage.
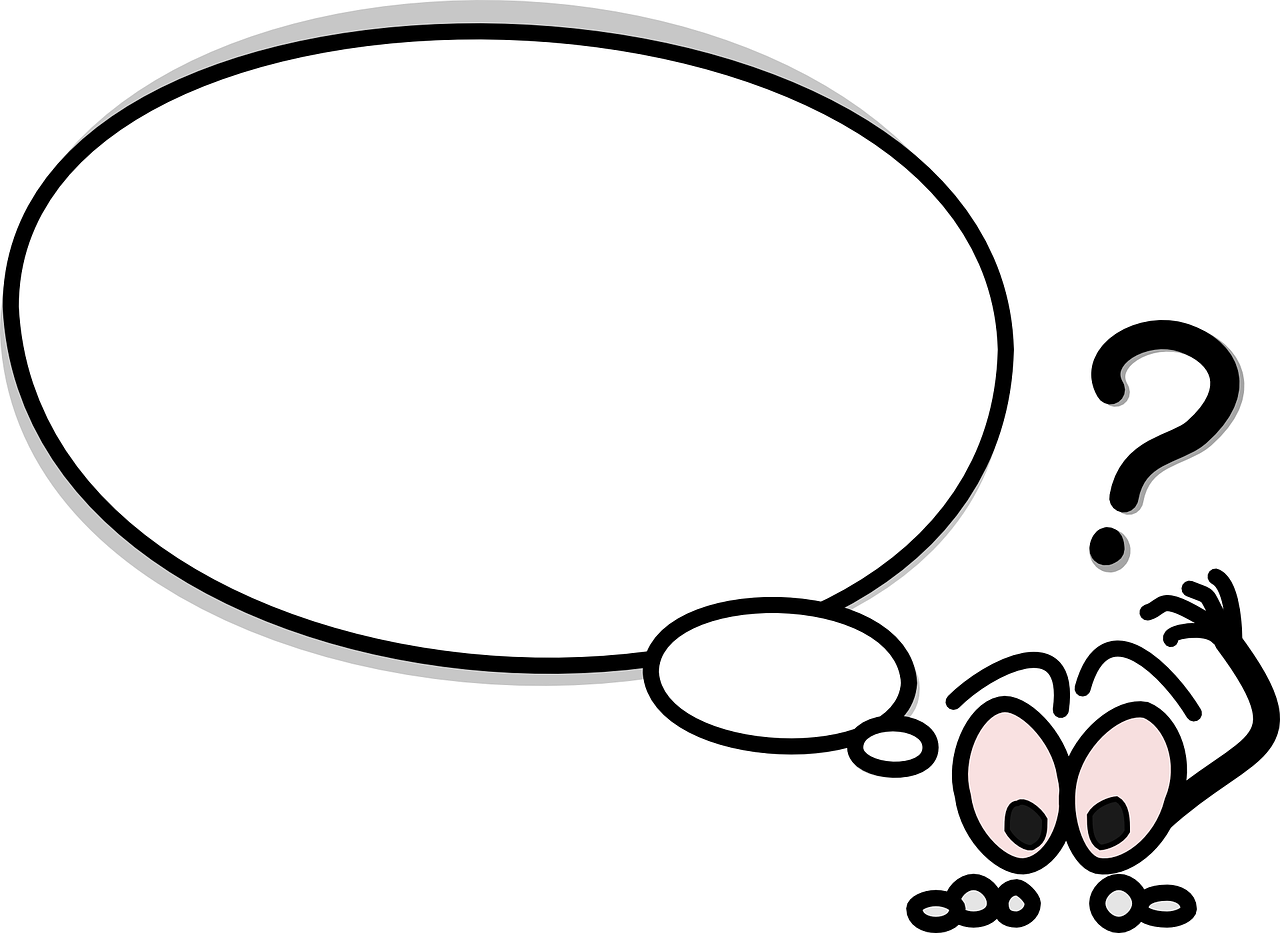
Pourquoi parlez-vous d’un « effet trompe l’œil » lorsque vous parlez de la meilleure réussite des filles à l’école ?
D. MARTINOT
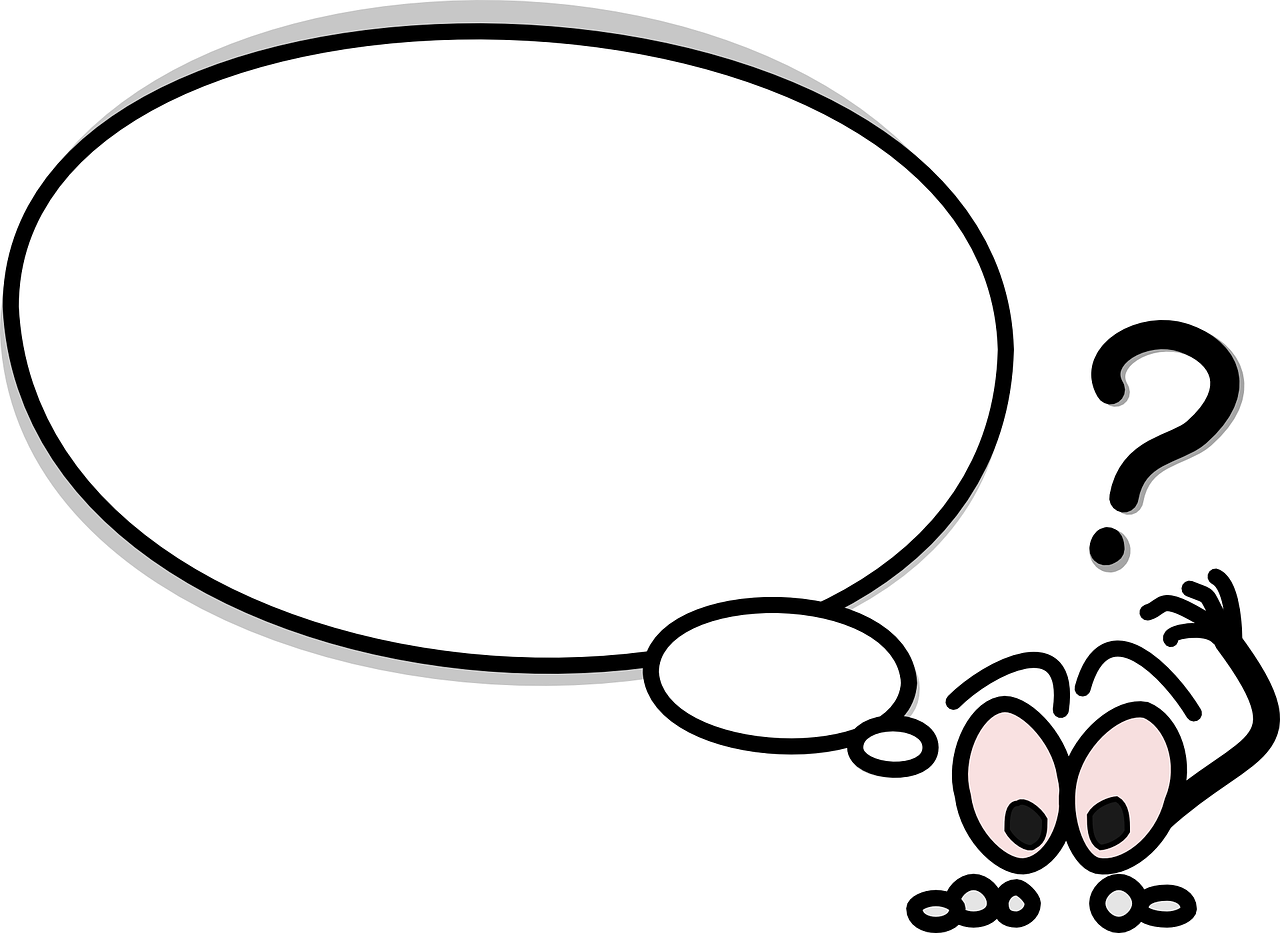
Cela a-t-il un effet sur la santé mentale à l’âge adulte entre les femmes et les hommes ?
D. MARTINOT :

Pour conclure, que diriez-vous directement aux enfants/adolescents autour de cette question ?
D. MARTINOT :
J’aimerais leur dire de ne jamais accepter les injustices existantes ; toujours revendiquer plus d’égalité que ce soit dans le fonctionnement de leur classe, de leur établissement scolaire. S’ils constatent des inégalités, des injustices, qu’ils luttent contre et qu’ils ne les intériorisent pas comme quelque chose de déplaisant et qui fait mal (sentiment de privation relatif qui a des effets de santé physique et mentale négatifs) ; se dire : « Non, je ne l’accepte pas ! »
La deuxième chose serait de lutter collectivement, toujours faire en groupe, trouver du soutien social pour dire ce qui n’est pas acceptable ; ne pas le faire seul parce que c’est trop difficile et cela peut aussi être épuisant. Il faut que le discours soit le même, pour les filles comme pour les garçons, si l’on veut que les choses changent. J’aimerais que ce soit un message commun car c’est bien que les garçons/hommes estime que ces questions les concernent aussi. Il faut que les deux groupes, ou mieux tous les groupes (en élargissant les inégalités de genre aux inégalités socio-culturelles ou ethniques), veuillent aller vers davantage d’égalité : que l’on soit du « bon » ou du « mauvais » côté, il faudrait que chacun prenne conscience d’une situation inégalitaire et souhaite la faire évoluer ensemble vers l’égalité.
Pour aller plus loin …
Interview de Pascale HAAG – Développer le bien-être des élèves
Comment définir l'adolescence ? La comprendre ? Quelles sont les spécificités cognitives et émotionnelles de cette période ? maître de conférences à l’EHESS de Paris, et affiliée au laboratoire « BONHEURS » de l’Université de Cergy Pontoise. Pascale a participé...
Le cerveau des adolescents : émotions, prise de risque
Insolents, irrespectueux, inconscients, irrationnels, idéalistes, les adultes dans leur grande sagesse ne manquent pas d’adjectifs négatifs pour qualifier cette période de développement si particulière entre l’enfance et l’âge adulte qu’est l’adolescence. Les...
Mon enfant est-il accro aux jeux videos ? Bruno ROCHER & Lucie Gailledrat (2020)
A propos des auteurs Bruno ROCHER est psychiatre, addictologue et thérapeute familial. Responsable d'une unité de soins ambulatoires en addictologie au CHU de Nantes, il a passé sa thèse de médecine en 2007 sur la question de l'addiction aux jeux vidéo et a...
Interview de Bruno ROCHER: L’addiction aux jeux vidéos
Bruno est psychiatre, addictologue et thérapeute familial. Il est responsable d'une unité de soins ambulatoires en addictologie au CHU de Nantes, et il a participé au Co'ciliabule de la RéCRÉ qui a eu lieu le 30 juin 2021 portant sur "les écrans et les jeux vidéos"....
Les pouvoirs cachés de votre cerveau – John Medina – 2021
A propos de l'auteur De formation biologiste moléculaire du développement du cerveau et des troubles psychiatriques, John Medina possède un parcours professionnel très riche: consultant dans les industries biotechnologiques et pharmaceutiques, professeur affilié de...
Interview de Christine Morin Messabel : Quels impacts des stéréotypes de genre sur le développement de l’enfant ?
Professeure de psychologie sociale à l'Université Lumière Lyon 2, Christine a participé au Co'ciliabule de la RéCRÉ qui a eu lieu le 31 mars 2021 portant sur "les garçons et les filles à l’école". Quel est l’état de la recherche sur les différences entre les filles...